Chaque jour, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité RTE doit équilibrer la production et la consommation d’électricité. Cela suppose de pouvoir mesurer en temps réel, ou bien estimer avec précision la production et la consommation d’électricité. L’essor du solaire photovoltaïque a entraîné une multiplication du nombre de systèmes raccordés au réseau. Or l’essentiel de ces systèmes, représentant 5 GWc, est dit “diffus” et n’est pas observé, puisque RTE ne peut ni en mesurer la production en temps réel ni l’estimer avec précision.
RTE et l’Agence internationale de l’énergie ont étudié cette situation et souligné que sans progrès importants de l’observabilité du PV diffus, le niveau de marges de sécurité, nécessaires au bon fonctionnement du réseau, pourraient s’accroître fortement d’ici à 2050.
Afin de pallier ce manque d’observabilité, RTE a financé un travail de thèse, soutenue en 2024 et dont les principaux résultats sont en cours de publication dans des revues scientifiques. Ce travail a contribué à répondre à la question suivante : quelle est la précision des méthodes d’estimation de production actuellement déployées par le gestionnaire de réseau de transport (GRT) pour estimer la production PV et est-ce que des approches alternatives peuvent améliorer l’observabilité à l’échelle nationale ?
L’étude s’est focalisée sur les méthodes de reconstruction des courbes de charge, qui consiste en l’attribution d’une production à chaque système connecté et répertorié par RTE. Cette reconstruction est cruciale car elle fonde les prévisions futures et le règlement des écarts.
Des modèles d’estimations plus fiables que prévu
RTE reconstruit les courbes de charge à partir des relevés de production. Lorsqu’aucun relevé de production n’est disponible – ce qui est par définition le cas pour les systèmes non observables – le GRT utilise une méthode d’extrapolation statistique fondée sur les centrales les plus proches. Cette méthode, connue et établie dans la littérature sous le nom d’upscaling, fonctionne bien lorsque l’on cherche à combler le manque de mesures de production entre centrales de caractéristiques similaires. Cependant, il était jusqu’alors impossible de dire à quelle point cette méthode était précise pour le cas des installations sur toiture.
Notre étude s’est donc appuyée sur un échantillon de systèmes sur toiture inédit répartis sur le territoire français pour vérifier l’efficacité de cette méthode. Pour ces systèmes, nous avons eu accès à leurs mesures de production réelles, mais aussi à leurs caractéristiques techniques et localisation précise. Nous avons pu ainsi simuler la méthode utilisée par RTE sur ces systèmes, et la comparer à une méthode alternative, proposée dans le cadre de la thèse et utilisant un modèle physique simplifié de l’installation et des météo pour estimer la production des petits systèmes photovoltaïques.
Les résultats montrent que les deux méthodes affichent des performances similaires avec 8 % d’erreur moyenne. La méthode de RTE s’avère robuste, tandis que l’approche physique, légèrement plus précise, reste plus sensible aux erreurs de paramétrage. Ainsi et pour la première fois, cette étude a permis d’estimer la précision des données de production PV fournies par un gestionnaire de réseau de transport français. Il s’avère que ces estimations sont plus fiables que prévues, et que des méthodes alternatives peuvent au mieux égaler la performance de la méthode utilisée par RTE. Mais cela signifie-t-il pour autant que la question de l’observabilité du PV est résolue ?
Les limites de l’extrapolation statistique
L’estimation de production à l’échelle d’un système s’avère être précise. Néanmoins, derrière cette précision apparente se cachent deux limites importantes, mais surtout indépassables : les différences de caractéristiques entre les centrales PV et les installations sur toiture comptent pour la moitié de l’erreur de la méthode d’estimation utilisée par RTE. Or, cet écart entre les caractéristiques de la production issue des centrales et des celle des installations sur toiture va croître, en raison, d’une part, de la hausse attendue des rendements des installations PV et de leur modulation lors d’épisodes de prix négatifs (qui entraînent un écrêtement de la production en milieu de journée) et, d’autre part, du développement de l’autoconsommation, dont l’effet sur la courbe de charge d’un foyer reste encore à déterminer.
A contrario, la méthode physique offre plus de flexibilité et semble mieux adaptée à la prise en compte de l’autoconsommation. En effet, la qualité de l’estimation présente un potentiel d’amélioration plus grand, par exemple en prenant en compte les ombrages autour des systèmes ou en améliorant la précision des algorithmes de détection des installations. Par ailleurs, si le modèle physique seul n’est pas adapté à la modélisation de l’autoconsommation, il apparaît comme une brique essentielle afin d’estimer cette dernière, que ce soit à l’échelle d’un foyer, d’un quartier ou d’une région donnée. A l’heure où 60 % des systèmes sont désormais raccordés en autoconsommation, la prise en compte de ce phénomène dans les modélisations de la production est indispensable.
Au delà de l’estimation de production, la véritable incertitude vient de la connaissance de la puissance installée PV
Toutes les méthodes évaluées dans cette étude reposent sur l’hypothèse que la puissance installée du système est connue : or, non seulement cette hypothèse n’est pas vérifiée en pratique, mais, à l’échelle des petits systèmes sur toiture, l’erreur d’estimation de la production est avant tout sensible à la puissance installée.
Les données d’installation remontées par Enedis et les autres gestionnaires du réseau de distribution alimentent le registre national d’installations (RNI), consolidé par RTE et mis à jour trimestriellement. Le RNI est cependant sujet à des incertitudes, que ce soit en termes de précision quant aux dates de raccordements, de puissance installée rapportée ou du nombre exact de systèmes. Des erreurs dans les registres publics ont ainsi déjà été mises en avant, comme par exemple en Allemagne, pays qui fait pourtant office de modèle en la matière. Face à la célérité de la croissance du PV sur toiture et compte tenu de la crucialité de la connaissance de la puissance installée, disposer d’outils permettant de vérifier la précision du RNI et, le cas échéant, de le rectifier rapidement paraît indispensable afin de s’assurer que la production PV est correctement estimée. Les méthodes de télédétection par IA apparaissent comme une solution prometteuse à l’échelle nationale.
L’enjeu de l’observabilité du PV sur toiture apparaît donc avant tout comme un enjeu de connaissance précise du parc PV installé. Dans un contexte où la puissance solaire installée croît de 25 % par an, cette recherche souligne que les défis de l’observabilité du solaire résidentiel ne sont pas insurmontables, à condition de mobiliser les bons outils et de coordonner les acteurs impliqués. L’expérience pakistanaise, où une explosion non planifiée du solaire sur toiture a mis en difficulté les gestionnaires de réseau, souligne “l’absolue nécessité d’une planification proactive et d’investissements opportuns” pour que le réseau puisse faire face à ces transformations rapides.
Par ailleurs, au-delà de la connaissance précise du parc installé PV, l’autoconsommation redessine progressivement les courbes de charges résidentielles selon des modalités encore en cours d’investigation. Cette transformation, bien qu’elle représente un défi pour la précision des modèles d’estimation actuels, ouvre également la voie à de nouvelles approches méthodologiques qui intégreront ces évolutions d’usage pour maintenir et renforcer la fiabilité des prévisions de production et de consommation.

Gabriel Kasmi est chercheur postdoctoral aux Mines Paris – PSL, après une thèse réalisée chez RTE sur l’observabilité du photovoltaïque (PV) sur toiture. Ses recherches portent sur la télédétection, l’IA explicable et l’observabilité des systèmes PV sur toiture, avec un focus sur la fiabilité et la transparence des algorithmes de deep learning.
Série coordonnée par Marie Beyer.
The views and opinions expressed in this article are the author’s own, and do not necessarily reflect those held by pv magazine.
Ce contenu est protégé par un copyright et vous ne pouvez pas le réutiliser sans permission. Si vous souhaitez collaborer avec nous et réutiliser notre contenu, merci de contacter notre équipe éditoriale à l’adresse suivante: editors@pv-magazine.com.






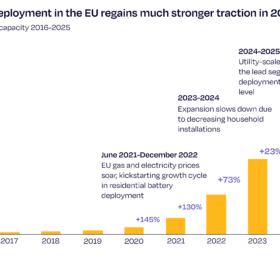
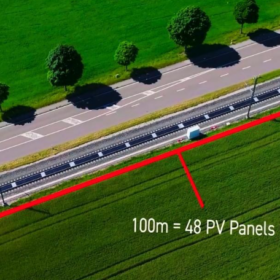
En transmettant ce formulaire vous acceptez que pv magazine utilise vos données dans le but de publier votre commentaire.
Vos données personnelles seront uniquement divulguées ou transmises à des tierces parties dans une optique de filtre anti-spams ou si elles s’avèrent nécessaires à la maintenance technique du site web. Un transfert de vos données à des tierces parties pour toute autre raison ne pourra se faire que s’il est justifié par la législation relative à la protection des données, ou dans le cas où pv magazine y est légalement obligé.
Vous pouvez révoquer ce consentement à tout moment avec effet futur, auquel cas vos données personnelles seront immédiatement supprimées. Dans le cas contraire, vos données seront supprimées une fois que pv magazine aura traité votre requête ou lorsque le but du stockage des données est atteint.
Pour de plus amples informations sur la confidentialité des données, veuillez consulter notre Politique de Protection des Données.