Publié en juillet 2023 par l’Institut Terram et signé par Lova Rinel, commissaire à la Commission de régulation de l’énergie (CRE), le rapport “Énergie en Outre-mer : enjeux d’un service public sous contrainte” analyse les réalités et les perspectives énergétiques des zones non interconnectées (ZNI), qui regroupent notamment les départements et régions dits d’outre-mer (DROM), la Corse et certaines îles métropolitaines.
L’étude souligne que, si la péréquation tarifaire garantit aux habitants des ZNI un prix de l’électricité identique à celui de la métropole, les conditions réelles d’accès au service restent inégalitaires avec des coupures fréquentes, des délais de raccordement longs et des infrastructures sous-dimensionnées ou mal adaptées aux contraintes locales. Elle propose « d’aborder la question énergétique non pas uniquement sous son angle technique mais comme un révélateur des dynamiques politiques à l’œuvre », une vision élargie donc de la stratégie énergétique, qui permet de repenser les choix technologiques de la transition dans ces territoires, y compris pour le solaire !
Gouvernance éclatée et manque de vision
Premier constat : la politique énergétique ultramarine repose sur une gouvernance fragmentée : le ministère des Outre-mer n’a pas compétence en énergie puisque ce domaine est piloté depuis Paris par la DGEC, qui officie sous l’autorité du ministère de l’Économie et des Finances et du ministère de la Transition écologique. La CRE assure un rôle de régulateur, EDF opère la production et la distribution via ses antennes et les collectivités locales valident et déploient les plans pluriannuels de l’énergie (PPE)… souvent rédigés par des cabinets de conseil externes, sans réelle appropriation politique.
« Le déficit d’incarnation politique empêche l’émergence d’une vision territorialisée, différenciée et ambitieuse. Cette absence ce stratégie unifiée crée un vide où s’empilent dispositifs techniques, expertises externes et ajustements à court terme. Faute de projection industrielle, l’énergie reste un outil de subsistance, sans levier de développement », explique Lova Rinel, ajoutant que « la transition énergétique dans les ZNI ne peut pas reposer sur les modèles continentaux ».
Photovoltaïque et stockage sous contrainte
Concernant le photovoltaïque, l’étude met en évidence les limites des solutions standards importées. Et pour cause, dans les environnement équatoriaux et tropicaux, les panneaux solaires subissent une corrosion accélérée et un encrassement rapide. A Cayenne, par exemple, les modules doivent être nettoyés manuellement, parfois toutes les deux semaines, pour continuer à produire. Des travaux réalisés au Sénégal (qui s’appliquent à ces territoires situés sur la même latitude) estiment que la dégradation annuelle des modules peut atteindre 2 à 3 %, entraînant une perte de performance de près de 20 % en 10 ans malgré un entretien régulier.
Pour le stockage aussi, bien que très attractif pour stabiliser et soutenir des réseaux moins développés, le bas blesse. Les batteries se révèlent peu fiables sous climat tropical, avec une durée de vie réduite et des risques accrus d’incendie. La CRE déconseille même explicitement leur déploiement décentralisé en Guyane, estimant que ce développement est trop couteux et peu fiable pour la régulation du réseau. A Mayotte aussi, les systèmes solaire+stockage nécessitent une maintenance deux à trois fois plus fréquente que prévu, ce qui compromet leur viabilité économique.
« La transition énergétique, telle qu’elle est généralement conçue depuis les centres de décision continentaux, repose sur des standards techniques, des modèles économiques et des principes de rendement élaborés dans des contextes de forte densité urbaine et de large accessibilité technologique mais ne s’applique pas aux ZNI », résume l’autrice. Même si elle ne porte pas sur une ZNI, une étude a mis en évidence que, dans un climat équatorial humide, les performance des installations photovoltaïques peuvent être jusqu’à 25 % inférieures aux simulations basées sur des modèles européens et que le coût actualisé de l’énergie (LCOE) peut y être 30 % plus élevé.
« À noter que le manque d’études académiques publiées sur le sujet des performances photovoltaïques en ZNI françaises constitue justement un vide stratégique à combler. » Pourtant ces dispositifs continuent d’être promus dans les appels d’offres nationaux, les PPE et les feuilles de route ministérielles, sans accroches locales. « Les trajectoires de transition énergétique dans les ZNI ne peuvent donc pas être fondées sur des technologies standardisées, conçues pour d’autres latitudes et d’autres réseaux. Elles nécessitent au contraire des solutions élaborées spécifiquement pour durer et fonctionner dans des milieux contraints », engage Lova Rinel.
Vers une énergie de développement ?
« Dans ce contexte, la France porte la responsabilité de transformer cette expérience sous contrainte en capacité d’innovation contextuelle. Cela implique de dépasser une logique de simple transfert de solutions techniques pour engager une véritable réarticulation des savoirs, explique Lova Rinel. Ingénierie publique, collectivités locales, opérateurs énergétiques, monde académique et expertises territoriales doivent être mobilisés dans une démarche de coconception, fondée sur la sobriété opérationnelle et l’adaptation fine aux réalités locales. »
Les références techniques citées dans le rapport étayent la nécessité d’un dimensionnement et d’un choix de matériels adaptés (verres, encapsulants, joints, connectiques, boîtiers, trackers, onduleurs) et de plans d’opération et de maintenance adaptés (fréquence de nettoyage, monitoring d’isolement, protections contre l’humidité), chiffrés et valorisés au niveau local.
Le rapport suggère une ingénierie contextualisée menant à des innovations adaptées et performantes. Il documente plusieurs exemples où des solutions énergétiques robustes ont émergées, comme sur l’île de Molène où a été mis en place un impluvium multifonction combinant captation d’eau de pluie, production solaire et stockage énergétique. Ce projet « modeste » mais intégré est né de la coopération entre habitants, élus, techniciens, institutions locales et autorités de régulation et illustre qu’un montage technique et institutionnel aligné sur les besoins réels et les capacités de maintenance locales peut fonctionner.
Alors que jusqu’à 70 % de la consommation électrique est résidentielle dans les ZNI, le rapport interroge l’articulation entre politiques socio-économiques, stratégie énergétique, développement industriel et innovation. « Envisager une véritable stratégie d’industrialisation dans les ZNI suppose une remise à niveau systémique du réseau électrique : production, stockage, distribution, mais aussi gouvernance, souligne Lova Rinel. À ce titre, les ZNI apparaissent comme des laboratoires en avance sur les défis énergétiques à venir, en particulier pour les pays du Sud. Elles posent des questions fondamentales : comment électrifier sans détruire, croître sans dépasser, se développer dans la contrainte ? Ce sont à ce titre des matrices d’expertise pour le xxie siècle. »
Ce contenu est protégé par un copyright et vous ne pouvez pas le réutiliser sans permission. Si vous souhaitez collaborer avec nous et réutiliser notre contenu, merci de contacter notre équipe éditoriale à l’adresse suivante: editors@pv-magazine.com.

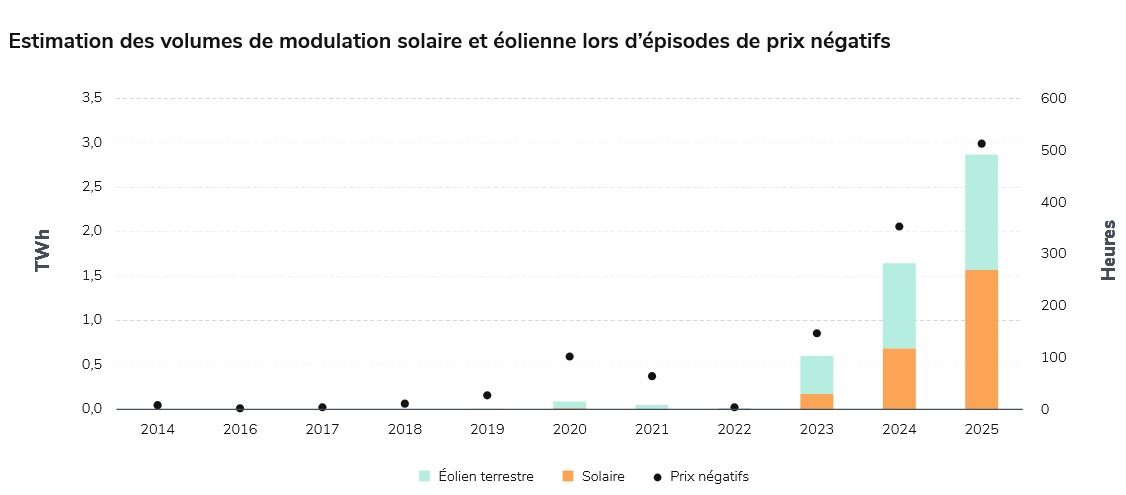




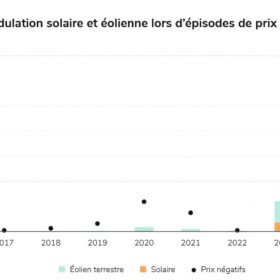


En transmettant ce formulaire vous acceptez que pv magazine utilise vos données dans le but de publier votre commentaire.
Vos données personnelles seront uniquement divulguées ou transmises à des tierces parties dans une optique de filtre anti-spams ou si elles s’avèrent nécessaires à la maintenance technique du site web. Un transfert de vos données à des tierces parties pour toute autre raison ne pourra se faire que s’il est justifié par la législation relative à la protection des données, ou dans le cas où pv magazine y est légalement obligé.
Vous pouvez révoquer ce consentement à tout moment avec effet futur, auquel cas vos données personnelles seront immédiatement supprimées. Dans le cas contraire, vos données seront supprimées une fois que pv magazine aura traité votre requête ou lorsque le but du stockage des données est atteint.
Pour de plus amples informations sur la confidentialité des données, veuillez consulter notre Politique de Protection des Données.